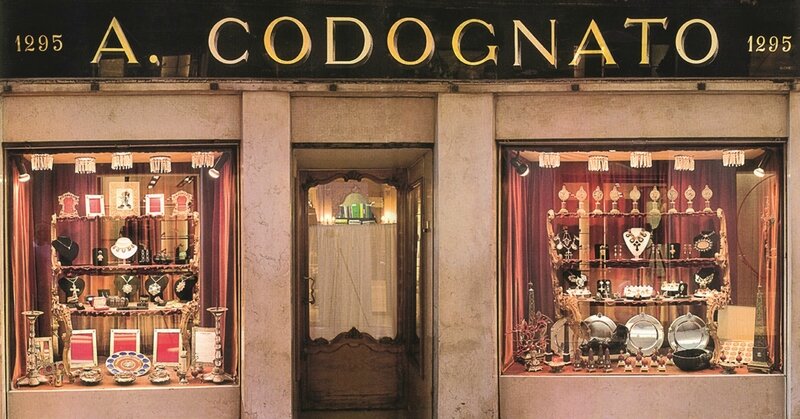Reportage. Donnée pour morte en 2008 à cause de la crise, l’industrie américaine de la voiture vit une révolution sans pareille en un siècle d’histoire. Avec l’appui déterminé des pouvoirs publics.
La Dodge Grand Caravan glisse le long de la rectiligne Woodward Avenue puis débouche sur la place Campus Martius, le cœur de Detroit. Au volant, Kenneth ne peut s’empêcher de manifester sa fierté: «Regardez, le centre-ville est devenu magnifique après son réaménagement. A midi et en fin de journée, c’est plein de monde aux terrasses des cafés et des food trucks ou encore aux abords de la grande fontaine.
Ce jeune retraité de l’enseignement arrondit ses fins de mois en faisant le chauffeur Uber. Toujours en conduisant, toujours avec le même plaisir, il parle encore des signes de renaissance de «Motor City », du gratte-ciel flambant neuf d’Ernst & Young, des édifices des années 1920 et 1930 restaurés, du chantier du tramway qui doit relier Campus Martius à la gare de chemin de fer située à cinq kilomètres de là…
Kenneth a raison: Detroit revient de loin. Après avoir incarné depuis près d’un demi-siècle tous les malheurs de la Rust Belt, cette «ceinture de rouille » des régions industrielles du nord-est des Etats-Unis marquées par les fermetures d’usines, le chômage de masse et une criminalité endémique, la ville plongeait, en 2013, dans la faillite la plus spectaculaire d’une collectivité publique américaine avec une dette de 20 milliards de dollars.
Cet effondrement suivait de quatre ans un autre traumatisme, celui du sauvetage in extremis de Chrysler et de General Motors. Ecrasés de dettes, confrontés à la chute vertigineuse de leurs ventes en raison de la crise financière, les deux mastodontes de l’automobile s’étaient mis en faillite. Ayant pris du retard sur leurs concurrents asiatiques et européens, ils paraissaient condamnés. Ce n’est que grâce aux aides massives du gouvernement américain qu’ils ont pu rester en vie.
Depuis, ils se sont réorganisés pour aligner de nouveau les bénéfices en milliards. Et surtout, ils ont su accompagner une «révolution jamais vue en plus d’un siècle de l’histoire automobile », comme l’a spécifié l’un des principaux patrons de la branche lors d’une conférence à huis clos à la prestigieuse université californienne de Stanford début octobre.
Une révolution que Damien Scott, cofondateur du Stanford/Harvard Forum on the Future of Transportation (SHFFT), une plateforme d’échange entre les deux universités américaines, résume en quatre points: « La décarbonisation des sources d’énergie, la connexion des voitures entre elles via la 3G ou la 4G, l’autopartage et l’autonomisation de la conduite.»
Et que Susan Shaheen, codirectrice du Centre de recherche pour le transport durable de l’Université de Berkeley près de San Francisco, qualifie de «coïncidence entre plusieurs anciennes idées, laquelle a été facilitée par l’évolution de la technologie et par les effets de la crise économique. Le tout débouchant sur un potentiel déplacement de paradigme.»
Un bijou technologique
Malgré ces signes de renouveau, Detroit n’est pas encore tiré d’affaire. Le centre est réhabilité, mais il demeure encore bien peu fréquenté. Les commerces comme les restaurants y sont rares, l’atmosphère reste empreinte de tristesse. Dans la proche banlieue, où il est déconseillé de se déplacer autrement qu’en voiture, les stigmates de la crise persistent.
Les entrepôts et magasins à moitié abandonnés jalonnent ainsi les rues. Derrière eux, les anciens quartiers résidentiels ont fait place à des espaces verts après la destruction des petites maisons particulières si typiques de l’Amérique, tombées en ruine.
Les industriels de l’automobile, plutôt que de réinventer la mobilité, se concentrent sur ce qu’ils savent faire le mieux: construire des voitures. Cependant, leurs catalogues n’alignent plus ces gros cubes dévoreurs de pétrole, mais des modèles hybrides, électriques, et même des plug-in hybrid, autrement dit des hybrides à batterie rechargeable. Et conformément à leur habitude de géants mondiaux, ils y mettent les moyens.
Exploitée par General Motors, la Detroit-Hamtramck Assembly Plant est au cœur de cette renaissance. Ce colosse industriel, qui a remplacé en 1985 l’usine historique située dans un autre quartier de Detroit, recouvre l’équivalent de 514 terrains de football et emploie près de 3000 personnes. En dépit du vacarme inhérent à une si vaste installation, les ouvriers trouvent le moyen d’écouter de la musique sur leurs postes de radio.
Bienvenue dans un bijou technologique. La chaîne de montage, longue de 25 kilomètres, est toujours servie par une armée d’ouvriers. Là, l’image des Temps modernes de Charlie Chaplin n’est qu’un lointain souvenir, l’automatisation de chaque étape de production étant élevée. Si bien que 24 heures suffisent pour assembler l’un des quatre modèles produits ici : la Buick LaCrosse, la Cadillac CT6 ainsi que les Chevrolet Impala et Volt, dont la variante européenne s’appelle Opel Ampera.
Si les trois premiers modèles sont de classiques voitures à essence, le dernier prend une place à part dans le catalogue du constructeur: il est son modèle plug-in hybrid, celui sur lequel il s’appuie pour s’affirmer sur le marché de la voiture «verte». Et avec succès: la Volt occupe le premier rang du segment des plug-in hybrid avec 33% du marché, devant la Ford Fusion. Néanmoins, ce succès technique et commercial ne masque pas un autre changement majeur: Detroit a perdu la suprématie de l’innovation dans la mobilité individuelle.
Le chaudron californien
C’est désormais en Californie que se dessine le futur. Quittons alors les entrepôts rouillés, l’atmosphère brumeuse et pesante de ville convalescente du nord pour rejoindre, après cinq heures de vol au-dessus des Grandes Plaines et des Rocheuses, le soleil de la baie de San Francisco. Ses palmiers. Son air sec, ses matins frais, ses après-midi méditerranéennes. Ses hordes de voitures hybrides ou électriques. Et surtout sa rage d’inventer.
«Les voitures devenant de plus en plus des objets technologiques, il est évident que l’innovation dans ce domaine se déplace dans la Silicon Valley. Il n’y a pas une seule grande marque qui n’ait acquis sa start-up ou entretienne au moins une équipe de 20 à 30 spécialistes sur place», observe Christian Simm, directeur de Swissnex, la plateforme des entreprises suisses à San Francisco.
Tout ce mouvement se fait à la manière de la «Vallée», comme l’appellent affectueusement ses habitants: un (ou une) jeune, généralement issu d’une bonne université mais pas toujours, a une idée.
Il crée une société pour l’exploiter. S’il ne compte pas ses heures de travail et a beaucoup de chance, il peut convaincre des financiers, ou capital-risqueurs, de lui fournir les fonds. S’il les obtient, il a le droit d’espérer créer une structure assez solide pour être rachetée plusieurs millions – voire milliards – par une multinationale. Voire, consécration suprême, de provoquer une rupture technologique comme l’ont réussi Tesla, dans le domaine de la construction ainsi que le marketing automobile, et Uber dans l’économie du partage.
Tous les acteurs de ce chaudron des inventions sont convaincus d’une chose: dans dix ans, l’industrie automobile aura complètement changé. Des constructeurs majeurs, qui paraissent incontournables aujourd’hui comme Mercedes-Benz, Volkswagen ou General Motors auront subi le même sort que Kodak, le géant de la photo des années 1990 qui a fait faillite en 2012, s’ils ne prennent pas à temps le virage du numérique.
Mèche de cheveu rebelle et regard affirmé, Damien Scott en est convaincu. «Beaucoup d’innovations sont conduites à Wolfsburg (siège de Volkswagen, ndlr), Stuttgart (siège de Daimler et de Porsche, ndlr) et Detroit. Mais pas les plus importantes, parce que les équipes des grands constructeurs sont trop conservatrices, car trop hiérarchisées.»
Ce jeune Néo-Zélandais qui a passé l’essentiel de son enfance au Botswana, a rejoint les dirigeants de l’équipe de formule 1 Williams Martini avant d’entrer à Stanford, et entend bien s’attribuer une part de ce gâteau en créant sa propre affaire le moment venu. Son domaine de prédilection: les voitures autonomes, la grande tendance de cette année. Il reste toutefois très discret sur ses projets.
Richard Baverstock en est déjà à l’étape suivante. Ce Canadien trentenaire et barbu a fondé à l’été 2015 sa propre start-up dans son garage, suivant en cela la plus pure tradition de la Silicon Valley. Sa société, qui porte le nom amusant de Mogol, cherche à accroître la capacité d’anticipation des véhicules autoguidés. Et il est frappé par le grand changement dans l’atmosphère:
«Il est devenu plus facile de présenter de nouvelles idées et de retenir l’attention des investisseurs. Le tournant a été l’acquisition en mars dernier de Cruise, une start-up spécialisée dans les voitures autopilotées, par General Motors.» Ce qui a surtout focalisé l’attention, c’est le prix: 1 milliard de dollars! Aussi le marché est-il convaincu que, dans dix ans, toutes les voitures seront à pilotage autonome. Parmi ses acteurs les plus connus, Google et Apple. «Le dernier titulaire d’un permis de conduire est déjà né», assure Mario Herger, un consultant autrichien et auteur.
La réinvention de la mobilité
Vue du ciel, la Silicon Valley est une immense banlieue s’allongeant sur une centaine de kilomètres le long de la baie entre San Francisco au nord et San Jose au sud, traversée par quelques autoroutes et voies rapides, constamment embouteillées. Un peu comme si l’espace encore disponible entre Genève et Montreux, sous l’effet d’un fantastique développement, était rempli de petites maisons particulières, de centres commerciaux et de zones industrielles.
Le développement centré sur la voiture rend les transports publics notoirement insuffisants: sur sa seule ligne de chemin de fer traversant cette région, le Caltrain circule certes toutes les demi-heures, ou à peu près, en desservant quantité de gares. Ses convois, toujours tractés par des locomotives diesels, sont condamnés à la lenteur à cause d’innombrables passages à niveau!
Le TGV devant relier la ville du Golden Gate à Los Angeles en 2 h 40 est certes passé à la phase de réalisation l’an dernier après vingt ans de discussions. Mais ces travaux sont ralentis faute de financement suffisant.
Un tel cadre de vie a été naturellement le terreau idéal à la naissance de l’autopartage et des applications numériques qui l’accompagnent. Dans cette jungle urbaine, il n’est pas toujours aisé de savoir exactement où l’on se trouve pour appeler un taxi. C’est là que l’application de géolocalisation sur smartphone, couplée à l’autopartage, s’est révélée un progrès décisif : on clique, et dix minutes plus tard, la voiture arrive.
Uber l’a compris le premier, immédiatement suivi par son concurrent direct, Lyft, puis par d’autres sociétés plus profilées, comme Luxe (qui gare votre voiture au centre-ville de San Francisco à votre place), ou Zoox, qui a réussi à lever 200 millions de dollars en promettant une nouvelle disruption avec ses taxis sans chauffeur. Pour la spécialiste des transports Susan Shaheen, c’est même là que réside la vraie rupture: «Le coût du transport reste le même, mais il est supporté par un plus grand nombre d’agents », argumente-t-elle.
La mobilité plutôt que la voiture
Une rupture que les constructeurs n’auraient pas encore comprise, affirme Mark Platshon. «Ils réfléchissent encore en termes de «voitures». Pourtant la priorité du public n’est plus dans la possession du moyen de transport, mais dans le fait d’assurer sa mobilité!», affirme cet investisseur expérimenté. Et il sait de quoi il parle: il a participé à la faillite de Kodak en jouant les pionniers de la photo numérique.
«Je me souviens d’un meeting avec la direction du géant photographique en 1999: elle affirmait que le public resterait attaché à la détention de photos imprimées. Alors que, en fait, il voulait déjà partager ses images ! Aujourd’hui, celui qui a pris la place de Kodak dans la photographie, c’est Facebook.» Pour lui, «les constructeurs qui n’ont pas compris ce virage seront morts dans dix ans».
Si l’avenir n’est plus dans la possession de sa propre automobile, comment expliquer alors les projets fantastiques de Tesla? Le fabricant de voitures de luxe électriques a lui-même bouleversé le marché, non seulement par ses innovations (batteries, conduite autonome) mais aussi par son approche évolutive, celle qui consiste à procéder à des mises à jour à distance du logiciel, comme si ses voitures étaient de vulgaires smartphones.
Au niveau industriel, ses plans sont cependant terriblement classiques : accroître la production, pour passer de quelque 75 000 unités annuelles actuellement à un demi-million avant la fin de la décennie. Quand elle est électrique, la voiture fait encore rêver.
Il suffit de franchir la baie de San Francisco pour rejoindre son unique usine, à Fremont, à la lisière orientale de la Silicon Valley. Le bâtiment, blanc à l’extérieur comme à l’intérieur, est immense: 1,5 kilomètre de longueur, telle une baleine échouée sous le soleil de la Californie. Sur le parking, des dizaines de voitures électriques font «le plein» aux bornes de recharge.
A l’intérieur, des armées de robots rouges s’agitent dans tous les sens pour couper les tôles d’aluminium, assembler les batteries, poser les pièces sur la longue chaîne de montage d’où sortent quelque 2000 voitures par semaine. Une grande impression de propreté et de lumière se dégage de cette usine. On y trouve même une cafétéria avec terrasse intérieure!
L’entreprise baigne dans une épaisse culture du secret. Le visiteur ne peut prendre de photos qu’en quelques lieux bien précis. Et une bonne moitié du site, celle où s’assemble la technologie la plus stratégique, reste inaccessible. Combien d’ouvriers y travaillent? «Ce chiffre n’est pas rendu public », explique la société.
Preuve de ce succès, Tesla fait des petits et il n’est nul besoin d’aller loin pour en rencontrer. Retraversons la baie de San Francisco et rendons-nous dans la zone industrielle de Menlo Park, à quelques encablures du siège de Facebook, pour découvrir Atieva. Derrière ce nom fort peu connu se cache une vaste ambition, celle de produire 20 000 voitures électriques dès 2018.
La société, partiellement en mains chinoises, veut édifier une grande usine en un lieu qu’elle tient secret mais que les rumeurs de la Silicon Valley situent à Casa Grande, quelque 80 kilomètres au sud de Phoenix en Arizona.
Pour le moment, la start-up fondée en 2007, qui rassemble quand même 300 personnes dans son immeuble blanc, n’a pas grand-chose à présenter, sinon deux moteurs électriques exposés dans son hall d’entrée, et un petit film posté sur son site web montrant qu’une fourgonnette Mercedes équipée de ses moteurs accélère encore plus vite qu’une Ferrari ou… une Tesla. «Il y a encore beaucoup à créer dans le domaine de la voiture électrique, notamment dans la connectivité », se réjouit Zak Edson, directeur marketing.
Les conditions du succès
Le chaudron de la Silicon Valley se serait-il emparé de l’avenir de la voiture s’il n’avait pas reçu de puissants appuis gouvernementaux ? Son histoire est faite de subventions, directes et indirectes, à ses innovateurs et ceux d’aujourd’hui ne font pas exception. «Les aides ont stimulé la recherche de nouvelles sources d’énergie et le système du partage. Elles ont accéléré ce virage stratégique», estime Susan Shaheen.
Pour chaque voiture écologique achetée, le gouvernement fédéral accorde un rabais fiscal de 7500 dollars auxquels s’ajoutent 2500 dollars concédés par l’Etat de Californie. Tesla, SpaceX et SolarCity, les trois sociétés dirigées par Elon Musk, ont reçu ensemble des soutiens publics totalisant 4,9 milliards de dollars, sous forme de subventions directes et de rabais d’impôts.
Et c’est un financement militaire qui est à l’origine des recherches sur la conduite autonome. Si le virage a été pris si nettement, c’est parce que les entrepreneurs et l’Etat y ont vu la condition non seulement du sauvetage de cette industrie, mais aussi de sa renaissance.
Retrouvez la vidéo de la visite de l’usine general motors detroit-hamtramck