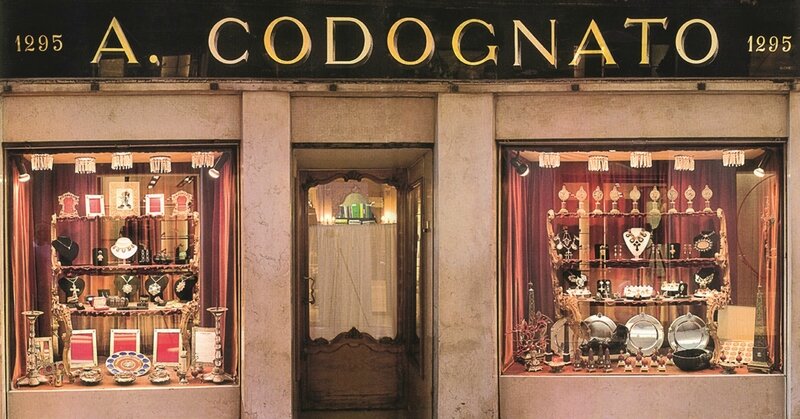Interview. Europe, Russie, Ukraine, Moyen-Orient: le géopolitologue, ex-ministre français des Affaires étrangères, analyse le monde tel qu’il est, tel qu’il pourrait devenir.
Où va le monde? Cette question retient généralement notre attention. Elle nous angoisse, un peu, beaucoup, plus rarement nous met en joie car la crainte du lendemain l’emporte. Les lendemains commencent aujourd’hui: les «peuples» d’Europe se rebellent contre les «élites», l’Union européenne ne fait plus recette, la Russie de Poutine réveille les démons de la guerre froide, le Moyen-Orient est pour partie sous la coupe djihadiste, l’islam fait peur, Israël inquiète. Difficile, par définition, de comprendre où va le monde, sinon, peut-être, à sa perte. C’est le «métier» du Français Hubert Védrine d’y voir clair. Ex-ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Lionel Jospin de 1997 à 2002, ce spécialiste de géopolitique dirige le cabinet parisien Hubert Védrine Conseil. Sa grille d’analyse est celle de la realpolitik. Dans sa bouche, ce terme n’est pas «péjoratif».
Assistons-nous à la mise en place d’une nouvelle guerre froide en Europe entre la Russie et l’Occident?
Je ne trouve pas que les termes de «guerre froide» soient appropriés. Il faut se rappeler que la guerre froide, depuis l’après-Seconde Guerre mondiale jusqu’à la fin de l’URSS, en 1991, était l’affrontement planétaire entre deux systèmes. Les deux blocs, l’Ouest et l’Est, prétendaient avoir une solution globale pour l’ensemble de l’humanité. Or on ne trouve pas dans la rhétorique russe actuelle, même la plus nationaliste, l’idée d’une solution de remplacement à l’américano-globalisation et au capitalisme dérégulé.
Quel nom donneriez-vous à cette tension européano-russe?
Ce qui se passe ressemble plus à un affrontement géopolitique régional que global à l’ancienne. C’est une microguerre dans l’Est de l’Ukraine. Il n’y a pas de mot bien adapté.
Parvenez-vous à lire dans les intentions de Vladimir Poutine?
En Occident, on ne voit que les torts de Poutine, qui sont très nombreux, bien sûr: il est facile de faire la liste de ses comportements ou de ses déclarations que l’on peut juger intolérables, que ce soit par rapport à l’Ukraine ou, en 2012, par rapport à la Géorgie. En revanche, ce qui n’est pas rappelé, c’est que Poutine est l’expression très majoritaire – il atteint jusqu’à 80% de popularité – d’un immense traumatisme du peuple russe après l’effondrement de l’URSS. Les Russes, à partir des années 1992-93-94, auraient perdu 30%, 40%, voire plus, de pouvoir d’achat!
L’Occident a-t-il, au début des années 90, manqué de tact?
L’effondrement des Russes a été traité avec une désinvolture à courte vue par les Occidentaux. Nous avons eu de la chance qu’il n’y ait pas eu pire que Poutine. Après le chaos instauré par Eltsine et le cambriolage généralisé des oligarques sur les ressources industrielles du pays, Poutine incarne une volonté très forte de se faire respecter à nouveau, avec les outrances que cela peut entraîner.
Au détriment de l’Europe?
Cela dépend de ce que l’on met dans le mot «Europe». Au point de départ, la politique de Poutine n’est pas un projet offensif ou expansionniste. C’est plus la réaction viscérale de celui qui ne veut plus être considéré comme un paillasson. Ses déclarations agressives par rapport à «l’Occident décadent» ont réveillé un nationalisme russe, qui n’est jamais très loin, surtout s’il est mortifié, l’Eglise orthodoxe prenant sa part dans cette exhortation au réveil. Ce faisant, ils ont sans doute actionné des forces qui les embarrassent maintenant…
Poutine n’a-t-il aucune volonté expansionniste?
Il faut se rappeler sa déclaration en entier: «Celui qui ne regrette pas l’Union soviétique n’a pas de cœur. Celui qui veut la reconstituer n’a pas de tête.» A mon avis, il ne touchera jamais aux Baltes, qui sont dans l’Europe et dans l’OTAN, même s’il y a des minorités russes ou russophones dans ces pays. En revanche, froid, intelligent et calculateur, et très affectif en même temps, il est là comme aux aguets à observer ce qu’on fait. Quand il y a de grosses bêtises en face, il en profite.
Vous faites allusion à ce qui s’est passé début 2014 à Kiev sur la place Maïdan?
Je fais surtout allusion à la volonté initiale du nouveau parlement ukrainien d’interdire l’usage de la langue russe.
Que va-t-il advenir de l’Ukraine?
Je pense, comme Henry Kissinger et Zbigniew Brzezinski (respectivement ex-secrétaire d’Etat de Richard Nixon et ex-conseiller à la sécurité nationale de Jimmy Carter, ndlr), qui ne sont pas des tendres, qu’on aurait dû fédéraliser l’Ukraine et la «finlandiser», une neutralité qui l’aurait laissée totalement libre sur le plan interne. On aurait même pu imaginer une garantie croisée, de la Russie et de l’OTAN. Jacques Chirac y avait pensé. L’idée contraire de George W. Bush de faire basculer l’Ukraine dans notre camp, de la faire entrer dans l’OTAN, était une erreur. Historiquement indépendante, toujours plus ou moins divisée, l’Ukraine devrait être un «pays-pont».
Comment sortir de la crise? Par une énième conférence?
La conférence, c’est utile si on a un contenu, un processus, des motivations. Cela suppose au bout du compte un compromis, réaliste, qui pourrait être le suivant: Poutine reconnaît formellement la souveraineté de l’Ukraine; Kiev donne des garanties pour les droits réels et une autonomie des communautés russophones de l’Est du pays; un nouveau référendum, incontestable, est organisé plus tard en Crimée sous supervision internationale; on reprend pragmatiquement l’accord d’association de l’Ukraine avec l’UE sur des bases prenant acte des liens de l’Ukraine avec l’ensemble russe et autre; on dit que l’Ukraine n’a pas vocation à faire partie de l’OTAN; on associe la Russie à quelque chose sur la sécurité en Europe autour de ce que Gorbatchev appelait «la Maison commune»; on relance les négociations nucléaires Etats-Unis-Russie, etc.
C’est ce qu’on appelle de la realpolitik.
Oui, et dans ma bouche, ce terme n’est pas péjoratif. Je trouve que l’irrealpolitik dans laquelle nous baignons est plus dangereuse. Mais je ne m’attends pas à ce que ce que je propose soit réalisé vite, car par rapport à son opinion publique aucun dirigeant occidental n’a intérêt à bouger, Poutine non plus. Mais il faudrait y penser pour ne pas rater l’occasion.
Cette «microguerre» russo-ukrainienne n’est-elle pas pour nous, Européens, une divine surprise? Elle obligera les Etats-Unis à s’impliquer à nouveau d’une manière beaucoup plus déterminée dans la sécurité du continent européen, le sentiment étant que les Américains nous ont un peu abandonnés à notre sort.
Il est vrai qu’en Europe la majorité des peuples voudraient bien vivre comme dans une grande Suisse, à l’abri du parapluie américain. Autrement dit, vivre dans un grand ensemble bénéficiant de conditions de vie parmi les meilleures, sans trop d’engagements internationaux sinon humanitaires, sans politique de puissance avec les risques que cela présente. Je pense que cette vision n’est pas tenable. Certes, un pays relativement petit comme la Suisse, qui a eu le courage de se défendre contre les empires voisins pendant très longtemps, peut préserver, avec un équilibre remarquable des langues et d’autres aspects, cet acquis historique. Mais je ne crois donc pas que ce schéma soit transposable à l’échelle d’un continent.
L’OTAN est-il notre horizon indépassable?
Jusqu’à un bouleversement structurel, oui. Il est évident que, après la Seconde Guerre mondiale, les Européens ont eu une peur bleue face à Staline. Ils ont tout entrepris pour que les Américains reviennent et s’engagent dans une alliance durable et contraignante, ce qu’ils n’avaient jamais fait. Et encore aujourd’hui, en dépit de tellement de colloques sur l’Europe de la défense, c’est la même chose. Les Européens veulent que les Américains restent impliqués, car ils s’en sont remis à eux. Ils se sont inquiétés de la relative prise de distance de Barack Obama, qui considérait rationnellement que son job principal n’était pas en Europe. Au-delà de cette appréhension, la machinerie de l’OTAN était dans une situation préoccupante: elle n’avait d’autre perspective que le bilan très mitigé de l’intervention en Afghanistan. Dans ce contexte, ce qu’a fait Poutine a été pour l’OTAN une divine surprise. On resserre les rangs, on va recomposer l’OTAN des années 50! Je crois que ce calcul est à courte vue.
Que proposez-vous à la place?
Une minorité, à laquelle j’appartiens, estime que nous, Européens, aurions dû profiter du désintérêt relatif, et rationnel, d’Obama pour nous affirmer. Pour qu’enfin, entre nous, ceux des Européens qui ont les moyens et la volonté s’organisent en un pilier de défense. Il serait dommage que les initiatives de Poutine nous fassent oublier à nouveau cette réflexion sur ce que nous devons entreprendre.
L’Union européenne est-elle en train de «crever»?
Je ne pense pas. L’épreuve de vérité, ce fut il y a six ans au moment de la crise des dettes souveraines. Pendant quelques mois, face au cas grec, l’Allemagne s’est interrogée: fallait-il supporter ce fardeau? La tentation était forte de s’en débarrasser, mais le risque d’un effondrement de la zone euro était alors énorme a-t-on cru. L’Allemagne, qui a un besoin vital du maintien de la zone euro, a compris qu’il valait mieux garder la Grèce dans le giron monétaire européen. La désagrégation de l’Europe est je pense écartée, en dépit de ce que racontent les euro-hostiles.
Le sauvetage est une chose, le sens en est une autre.
L’Europe est en effet prise dans une sorte de mer des Sargasses. On tourne en rond. Les peuples ne comprennent plus ce qu’est l’objectif.
Est-ce qu’une sorte de confédération à la suisse pourrait être un modèle à suivre pour l’Europe?
Pourquoi pas pour les 28? Mais ça, c’est la réponse institutionnelle. La question première est celle de l’objectif: pourquoi fait-on ça? Dans le langage cliché, «l’Europe, c’est la paix». Mais cela ne veut rien dire, car ce sont les Etats-Unis et l’URSS qui ont fait la paix en Europe en battant l’Allemagne nazie. L’Europe est la fille de la paix. Le projet européen était contenu en quelque sorte dans le plan Marshall. Le traité de Rome n’était pas à proprement parler un «projet», sauf d’un marché commun. L’idée de projet revient avec l’âge d’or européen à l’époque de Kohl-Mitterrand-Delors. Les projets se développent alors sans limites. Réapparaît même un courant fédéraliste, qui compte pour rien dans le corps électoral, mais qui mobilise beaucoup de médias et d’intellectuels.
Sommes-nous dans une impasse totale?
Non, c’est possible de réconcilier les élites et les peuples aujourd’hui, en disant que nous sommes viscéralement attachés, à notre mode de vie, à nos sociétés, qui sont quand même les meilleures de toute l’histoire de l’humanité, que nos intérêts et nos valeurs, c’est la même chose. Dans un monde concurrentiel, une entité qui ne défend que ses valeurs et pas ses intérêts n’est pas prise au sérieux et donc nous allons les défendre. Est-ce que cette reconnaissance de valeurs et d’intérêts communs suppose de fondre tous les peuples dans un peuple européen unique et mythique? Non. C’est l’erreur des fédéralistes d’avoir prétendu cela, et ils se sont aliéné les peuples.
Cela ne dit pas ce qu’il faudrait entreprendre.
Revenons à la «fédération d’Etats-nations» préconisée par Jacques Delors (président de la Commission européenne de 1985 à 1994, ndlr).
Une fédération d’Etats-nations, n’est-ce pas à la fois une chose et son contraire?
Justement, c’est cela sa force. C’est une synthèse, un paradoxe constructif. D’abord, il faut bien comprendre que l’idée fédérale ne passera jamais l’épreuve du vote. Il n’y a pas de chemin démocratique en Europe vers le fédéralisme. La Cour constitutionnelle de Karlsruhe s’y opposerait et au référendum, en France ou ailleurs, ça ne passerait pas. Ce n’est pas la peine de rêver. Imaginons maintenant qu’on soit dans un système fédéral, on ne sera pas pour autant dans «l’Europe-puissance» dont rêvent les Français. A la majorité et sans veto, ce ne sont pas des idées à la française qui l’emporteraient, sur aucun sujet. C’est pour cela que la formule de Delors est remarquable: il y a des éléments de fédéralisme, la monnaie en est un, mais les Etats-nations demeurent. Ce n’est donc pas la peine de tenir des discours sur l’éradication des identités nationales et de traiter de fascistes les gens qui «votent mal». C’est injuste et contre-productif.
Les questions identitaires échauffent les esprits. Elles se focalisent sur des aspects migratoires. Comment les prendre en compte?
Il faut raisonner chiffres et positions. Si on accepte, dans un pays, en trop peu de temps énormément de gens dont les modes de vie sont trop différents, il y a des réactions populaires vives qui ne disparaissent pas sans l’effet des condamnations par les élites. Si, à l’inverse, le rythme des arrivées est plus étalé dans le temps, ou si les quantités sont plus petites, et si l’écart entre les modes de vie et les croyances est moins fort, c’est plus facile à gérer. L’Espagne des dernières années a eu des problèmes avec l’immigration marocaine pourtant indispensable mais beaucoup moins avec ceux qui venaient d’Amérique hispanophone. Osons être concrets!
Le Moyen-Orient est pour une partie en feu et pour l’autre en alerte feu permanente. Cet ensemble de pays, héritage du partage franco-britannique de 1916, plus connu sous le nom d’accords Sykes-Picot, aura-t-il bientôt disparu?
Il peut y avoir une phase intermédiaire longue, dans laquelle, formellement, les frontières héritées ne sont plus respectées mais n’ont pas encore été remplacées par d’autres qui soient internationalement agréées et où l’anarchie règne sur le terrain. La désagrégation est en cours et on ne voit pas encore la recomposition, qui arrivera un jour ou l’autre. Soit la Syrie et l’Irak se reconstituent, peut-être pas tout à fait comme dans les atlas, soit il y a durablement une zone grise et un conflit «gelé». Je note que la désagrégation n’a pas commencé avec Daech, mais avec l’invasion américaine en 2003 ou, si l’on remonte avant encore, à l’agression insensée de Saddam Hussein contre l’Iran en 1980, puis son attaque sur le Koweït en 1990 dont il sera notamment puni par une zone d’exclusion aérienne au nord, qui est l’origine d’un Kurdistan de facto indépendant et le début, à proprement parler, de la décomposition de l’Irak.
Qui, dans le monde arabo-persique, va perdre des plumes, qui va en gagner?
Dans la phase de décomposition actuelle, tout le monde perd des plumes, sauf l’Iran. L’Iran est dans une situation difficile mais pas plus qu’avant depuis trente ans et sera réintégré un jour ou l’autre dans le jeu international, c’est inscrit dans l’histoire. Les déboires des Arabes ne sont un problème pour les Iraniens qu’à travers leurs répercussions sur les chiites, leur bras armé dans la région. Donc, pour l’Irak et la Syrie, la situation est mauvaise; pour l’Arabie saoudite et la Jordanie, c’est dangereux; les Emirats plastronnent un peu, mais la situation est risquée pour eux aussi. Bref, tous ces pays sont momentanément affaiblis. On ne voit pas de grand pays arabe sunnite tirer son épingle du jeu pour le moment.
Pas même l’Egypte?
L’Egypte peut-être si. Après être passé par le cycle Moubarak/Morsi qu’on a connu, le régime presque dictatorial au démarrage du maréchal Sissi, en tout cas beaucoup plus répressif que celui de Hosni Moubarak, a des résultats économiques et s’ouvre un peu. Sissi serait très fort s’il parvenait à réintégrer une partie des Frères musulmans dans un jeu démocratique contrôlé. Le fera-t-il?
Israël est-il en train de profiter du chaos moyen-oriental pour tenter d’avancer le plus loin possible ses pions en Cisjordanie?
Israël n’avance pas des pions, Israël colonise inexorablement et impunément depuis des décennies. Israël n’est pas tellement enchanté par ce qui se passe. Il s’accommodait très bien de la dictature Assad. A propos des printemps arabes, les Israéliens ont été les premiers à dire qu’on se faisait des illusions en Occident et que cela tournerait au chaos, dans la plupart des cas.
Où en est Israël? Le pays semble pris dans une fuite en avant qui semble à beaucoup irrationnelle.
Le problème, en Israël, est le suivant: du fait du scrutin proportionnel intégral, il n’y a pas de gouvernement sans alliance avec des extrémistes, nationalistes ou religieux, même quand le Likoud l’emporte. A fortiori une coalition de centre gauche n’a pas la majorité. Aucun gouvernement n’a la majorité pour régler ce problème palestinien qui devrait être résolu depuis des décennies. Le statu quo est une absurdité stratégique pour les Israéliens et pour ceux des Occidentaux qui les soutiennent aveuglément.
Comment résoudre le conflit israélo-palestinien?
Pas par le dialogue seulement israélo-palestinien, parce que les Palestiniens sont très faibles, ils ont déjà presque tout donné, sauf une ou deux dernières concessions qu’ils lâcheront à la fin. La résolution du problème devra partir de l’intérieur du système israélien lui-même. Ce n’est donc pas une affaire israélo-palestinienne mais, pour commencer, une affaire israélo-israélienne. Le paradoxe est le suivant: il y a dans l’opinion un camp de la paix presque toujours majoritaire dans les sondages, mais qui n’a pas d’expression politique, encore moins parlementaire, alors que le gouvernement est très sensible au lobby des colons radicalement hostile à toute concession territoriale. Il faudrait, dans l’idéal, un nouveau Yitzhak Rabin (ex-général de Tsahal, premier ministre de 1974 à 1977, puis de 1992 à 1995, ndlr) qui a été le vrai grand homme des Israéliens – ceux qui l’ont fait tuer ne se sont pas trompés!
Et des Etats-Unis déterminés.
Un nouveau Yitzhak Rabin, donc, appuyé effectivement par un président américain qui considérerait stratégiquement que, dans la relation islam-Occident, la question israélo-palestinienne est un abcès de fixation et un handicap qu’il faut résorber. Certes, le règlement de cette question n’arrangerait pas tout, mais sans cela on ne peut rien régler. Il faudrait au début un accord très solide israélo-américain, ensuite une négociation israélo-palestinienne très brève – tout le monde sait ce qu’il faut mettre dans l’accord –, un service après-vente très long pour gérer ensuite le désordre palestinien.
Profil
Hubert Védrine
1981 à 1995 Collaborateur du président François Mitterrand comme conseiller diplomatique, porte-parole et secrétaire général de la présidence. 1997 à 2002 Ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de Lionel Jospin, sous la présidence de Jacques Chirac. 2003 Crée une société de conseil géopolitique. Il est aussi l’auteur de nombreux ouvrages sur François Mitterrand ou la géopolitique.